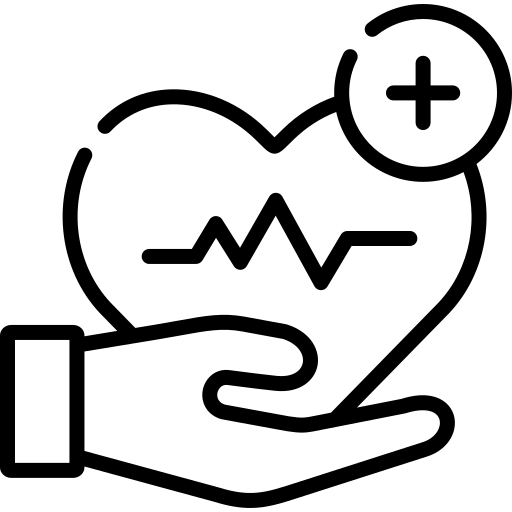Jean-Pierre, tu es psychiatre et psychanalyste, membre de l’Association lacanienne internationale. Tu exerces à Namur et à Bruxelles. En 1997, nous publiions Un monde sans limite dans la collection « Point hors ligne ». Ce livre, qui a eu un succès immédiat, a ouvert tout un champ de pensée et de recherches novateur à l’époque pour la psychanalyse mais aussi pour les domaines social et médico-social. Tu y affirmais que les mutations du lien social entraînaient des conséquences inédites sur la subjectivité de chacun. Ce livre a suscité de nombreux débats, dans les associations de psychanalystes ainsi que dans les équipes du secteur médico-social, notamment autour de questions comme : les patients (enfants, adolescents, adultes) d’aujourd’hui sont-ils différents de ceux d’hier ? Ont-ils des symptômes, voire des structures psychiques, différents ou est-ce juste une variation de l’expression de leur souffrance ? Peut-on parler de clinique en dehors du cabinet du psychanalyste ? Peut-on extrapoler les concepts de la psychanalyse au social ? En tentant d’analyser le déclin de la fonction paternelle dans notre société, tu as pu être accusé de regretter l’époque révolue du patriarcat et de la religion. Livre après livre, et à travers la collection « humus, subjectivité et lien social » que tu animes depuis 2004, tu t’es attaché à démonter cette allégation et à poursuivre ce travail en profondeur qui t’a conduit aujourd’hui à la parution de L’immonde sans limite. Peux-tu retracer l’itinéraire qui t’a amené en 20 ans du Monde à L’immonde sans limite ?
Jean-Pierre Lebrun : Lorsqu’en 1997, je publiais Un monde sans limite, j’étais dans la droite ligne de ce qui avait été ma thèse d’agrégation – que les éditions érès viennent d’ailleurs de republier sous un nouveau titre De la maladie au malade, psychanalyse et médecine dans la Cité – qui, déjà, prenait acte des changements dans la pratique médicale liés au tournant qu’avait pris la médecine en devenant véritablement scientifique. Comme je l’ai démontré dans ce travail, cela équivalait à une rupture avec la conception hippocratique. J’avais résumé ce trajet en complétant la formule de Claude Bernard : la médecine était l’art de guérir (les malades), elle doit devenir la science de guérir (les maladies). D’où pour rester humaine, un travail désormais s’impose à elle : refaire le trajet de la maladie au malade.
À la suite de ce livre, je me suis rendu compte qu’une même rupture avait eu lieu dans le discours sociétal : ce n’était plus la religion qui organisait notre société mais la science. En conséquence de quoi « la loi du père » – celle qui contraignait l’enfant aux renoncements nécessaires pour occuper sa place dans la société –, telle qu’elle avait fonctionné pendant des siècles, s’en trouvait complètement ébranlée, voire obsolète. Ceci a été souvent repris par les psychanalystes – pas nécessairement à bon escient, car cela a laissé penser que « loi du père » et « Nom-du-Père » étaient synonymes – sous l’appellation de « déclin du Nom-du-Père »… Plusieurs collègues se sont par ailleurs insurgés contre cette lecture, refusant la réalité de cette thèse qui n’aurait pas fait la distinction entre fonction paternelle et fonction patriarcale.
Je crois qu’aujourd’hui, il s’avère déterminant de ne pas dénier ce déclin, mais de le penser pour ce qu’il est : un déclin voulu et programmé suite au vœu de la multitude – et non d’une quelconque instance ou minorité, donc pas de théorie du complot – pour promouvoir l’accès à l’autonomie des sujets. Ce pas de plus demandait que nous acceptions de nous passer de la référence au père. Voilà pourquoi nous ne voulons plus aujourd’hui que les enfants soient ceux du père, nous voulons qu’ils deviennent les enfants des deux parents, tout ceci allant d’ailleurs dans le sens d’une nouvelle répartition des rôles parentaux réorganisés, à juste titre, autour de l’égalité hommes-femmes.
Mais la question devient alors : comment, en ne voulant plus qu’ils soient seulement enfants du père, ne pas les laisser devenir des enfants seulement de la mère ? En effet, on perçoit aussitôt la confusion possible : en voulant se débarrasser du père, on fait naître le risque de porter atteinte à tout ce que celui-ci avait aussi la charge de transmettre, à savoir l’ordre de la culture. C’est ce que nous voyons à l’œuvre et que nous déplorons. Nous pouvons attribuer ce fait, par exemple, à la mainmise de l’économie et du modèle néolibéral ; ce qui est loin d’être faux, mais n’éclaire en rien en quoi nous pourrions nous-mêmes, psychanalystes, avoir contribué à la méprise. Plus qu’à la nostalgie du père dont parlait hier Freud, il faut aujourd’hui penser en quoi c’est la nostalgie de la mère qui prévaut dans la société de marché.
Avoir pris « la loi du père » pour un invariant anthropologique – en laissant se confondre « loi du père » et « Nom-du-Père » – est une erreur : il existe bien un invariant mais ce n’est pas celui-là ! L’invariant, c’est le fait que nous sommes des êtres parlants, des « parlêtres » comme les appelait Lacan, et qu’à ce titre nous ne pouvons nous concevoir comme des individus se suffisant à eux-mêmes, déconnectés d’avec les autres.
C’est aux conséquences de cette confusion à l’œuvre depuis déjà deux générations – une quarantaine d’années – que nous avons aujourd’hui affaire et, de plus, nous prenons souvent le parti de ne rien vouloir en savoir, voire de le dénier.
MFDS : Tu parles dans ce livre de l’« individu total », celui qui ne doit rien à la société mais peut tout exiger d’elle. Peux-tu nous parler des incidences de cet individualisme exacerbé qui caractérise notre époque ? En quoi assiste-t-on à une nouvelle hégémonie culturelle ?
JPL : J’ai repris cette expression à Gramsci, car elle dit bien ce à quoi nous sommes soumis. Lacan rappelait que l’inconscient, c’est le social. Et bien oui, la forme que prend ce social détermine chacun d’entre nous. Depuis une quarantaine d’années, ce social a basculé dans une nouvelle architecture, insidieusement, sans crier gare, en mettant fin à la construction hybride collectif-singulier qui caractérisait la modernité : nous ne sommes plus dans un monde où la transcendance a encore sa place ; celle-ci n’est perçue que comme religieuse et il faut donc aussitôt s’en libérer. Nous ne sommes plus que des uns à côté des autres, sans plus rien devoir à une transcendance fût-elle laïque ou profane, et aussitôt prêts à prendre les armes si on nous rappelle que cette dernière est spécifique de notre rapport à la parole et au langage.
C’est pourtant parce que nous sommes des êtres de parole et de langage que nous sommes contraints, que nous le voulions ou non, d’intégrer cette dimension Autre, la dimension tierce du langage, avec toutes ses conséquences. « Être parlant » a des exigences qui, hier, se transmettaient via cette « loi du père », et qui aujourd’hui ont beaucoup de peine à se faire entendre, car elles ne sont plus perçues que comme des reliquats d’un patriarcat dont nous serions affranchis.
Il n’est pas difficile de penser qu’un tel changement a des conséquences déterminantes sur l’éducation, l’organisation de la famille, la tâche de l’école, la conception du travail… que nous voyons aujourd’hui se déployer, le plus souvent pour les déplorer. Comme si nous avions manqué le changement espéré…
MFDS : C’est ce qui te fait parler de « crise de l’humanisation » ?
JPL : Effectivement, c’est comme cela que je situe ce que nous traversons. Nous sommes contraints au travail d’humaniser depuis que le monde est monde : nous sommes obligés de préparer la génération qui suit à se confronter à ce qu’exige la condition humaine. Mais voilà, les changements survenus sont à ce point profonds qu’ils ont atteint le cœur même de la transmission. S’en est suivie l’illusion démesurée de pouvoir être débarrassé de toute autorité, de pouvoir ne miser que sur l’individu. Ceci entraîne chez certains une fuite en avant, chez d’autres un grand désarroi…
MFDS : Alors que la psychanalyse est attaquée de toute part – même par des députés qui réclament que soient exclus des tribunaux, des hôpitaux et des universités les psychiatres et les psychologues se référant à la psychanalyse – comment vois-tu l’avenir de cette discipline ? Qu’a-t-elle à apporter d’irréductible ?
JPL : Il faut distinguer ce que la psychanalyse peut apporter et ce que les psychanalystes ont fait de leur discipline. Nous ne pouvons nier que beaucoup s’en sont servis pour installer leur pouvoir et, de ce fait, briller par leur arrogance. Les années 1970-1980 ont été à cet égard stupéfiantes et certains croient qu’il faut poursuivre cette façon de faire. Nul doute alors que revanche oblige et ce n’est pas pour rien que les budgets changent aujourd’hui de main. Cela étant, la découverte freudienne a passé la rampe et elle fait désormais partie de notre patrimoine : nous savons que l’enfance est le terrain de notre réalité psychique à tous et que nous sommes ainsi largement tributaires des premiers moments de notre existence. L’intérêt porté aujourd’hui à l’enfant est une des conséquences de l’avancée freudienne et ce ne sont pas des modèles simplistes qui vont pouvoir rendre compte de la complexité d’une réalité psychique.
Ce que Alain Badiou a écrit récemment1 à ce propos me paraît pertinent : « Auparavant, ce n’était qu’une seule idée – souvent religieuse qui s’imposait – “Vis avec cette idée, et aucune autre’’. Aujourd’hui, c’est : “Vis sans idée’’ ». À ce titre-là, on peut aisément comprendre qu’il faille se débarrasser au plus vite de cette « boîte à idées » que constitue la psychanalyse. Comme je le dis dans la conclusion de mon livre, si elle doit passer un mauvais quart d’heure, je ne la vois nullement disparaître pour autant, mais à la condition déterminante qu’elle soit elle-même capable de contribuer aux idées, à de nouvelles idées, sans se fossiliser dans ses dogmes mais en consentant, sans renoncer à ce qu’elle soutient, à faire le travail nécessaire pour éclairer les nouvelles données avec lesquelles elle doit désormais fonctionner. C’est à cet endroit que la lecture de cette mutation d’hégémonie culturelle m’apparaît cruciale. C’est aussi pour cela que j’en appelle à ce que des collègues travaillent ensemble, au-delà de leurs appartenances institutionnelles, pour se remettre à l’épreuve de l’exogamie.
Tout ceci pour nous amener à frayer une troisième voie : ni « une seule idée », ni « pas d’idée », mais « des idées » ! Pour cela, nous devons fournir désormais un travail supplémentaire pour élaborer ces idées, les rendre possibles, et vivre ensemble avec elles.
S’il fallait résumer ma position, je souscrirais volontiers à cette phrase de Marcel Gauchet : « Pour des motifs hautement respectables, nous avons touché sans nous en rendre compte à des ressorts de la genèse subjective que nous ne soupçonnions pas. Il faut le regarder en face. Le combat des Lumières, ce ne saurait être, au nom des valeurs des Lumières, le refus obscurantiste d’explorer leur part d’ombre2. »
MFDS : En tant qu’éditeur très engagé aux côtés des psychanalystes, nous constatons que les lecteurs sont moins nombreux qu’avant, que les rayons des librairies sont plus étroits, qu’il y a davantage besoin d’accompagner les parutions par des rencontres, la présence des auteurs dans les colloques et journées d’études… Bref nous pensons que l’édition en psychanalyse, tout en maintenant un axe de recherche et d’approfondissement forcément pointu et sélectif, doit évoluer en direction des professionnels plus jeunes qui n’ont pas eu de formation universitaire ou clinique et en s’ouvrant aux autres disciplines des sciences humaines. Qu’en penses-tu ? Comment vois-tu l’avenir de la collection « Humus » et celle de « Singulier/pluriel » qui, bien que fondée sur la clinique et un langage accessible, a du mal à trouver son public ?
JPL : Je ne peux qu’acquiescer. Cela va nous demander d’abord d’apprendre à reparler la langue commune. Lacan rappelait dès 1953 « qu’un mur de langage pouvait s’opposer à la parole… » C’est plus que jamais d’actualité. C’est une réalité concrète que nous ne pourrons escamoter. C’est aussi pour cela que j’ai souhaité ouvrir cette autre collection, « Singulier/pluriel », qui accueille des textes de collègues de tous horizons pour témoigner de comment, avec les outils conceptuels de la psychanalyse et leurs singularités, ils ont pu soutenir un travail au quotidien en prison, avec des couples, en crèche, à l’école, à l’hôpital, en service d’urgence, en milieu médico-social… partout où l’on reconnaît avoir affaire à la réalité psychique d’un sujet, en consentant à sa complexité et à la nécessité de l’élaborer, tant que faire se peut.
1. A. Badiou et B. Cassin, Homme, femme, philosophie, Fayard, 2019, p. 180.
2. M. Gauchet, « L’enfant du désir », Le Débat, n°132, décembre 2004, p. 121.
À propos
Retrouvez chaque mois le texte de l'un de nos auteurs sur des sujets d'actualités