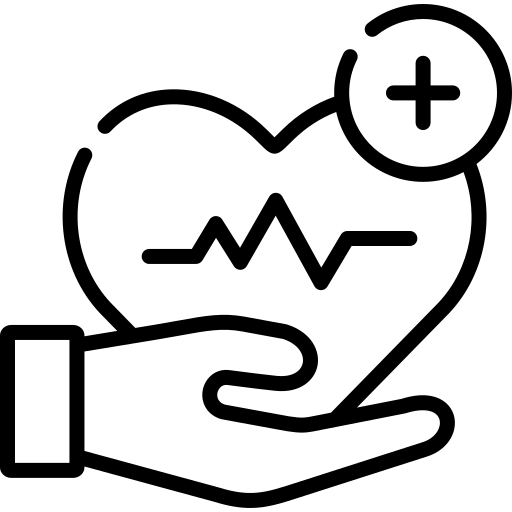"Réinventer le monde d’après : le délibéralisme" - Découvrez le Billet de Eric Dacheux et Daniel Goujon
Lire le Billet et l'extrait choisi par les auteurs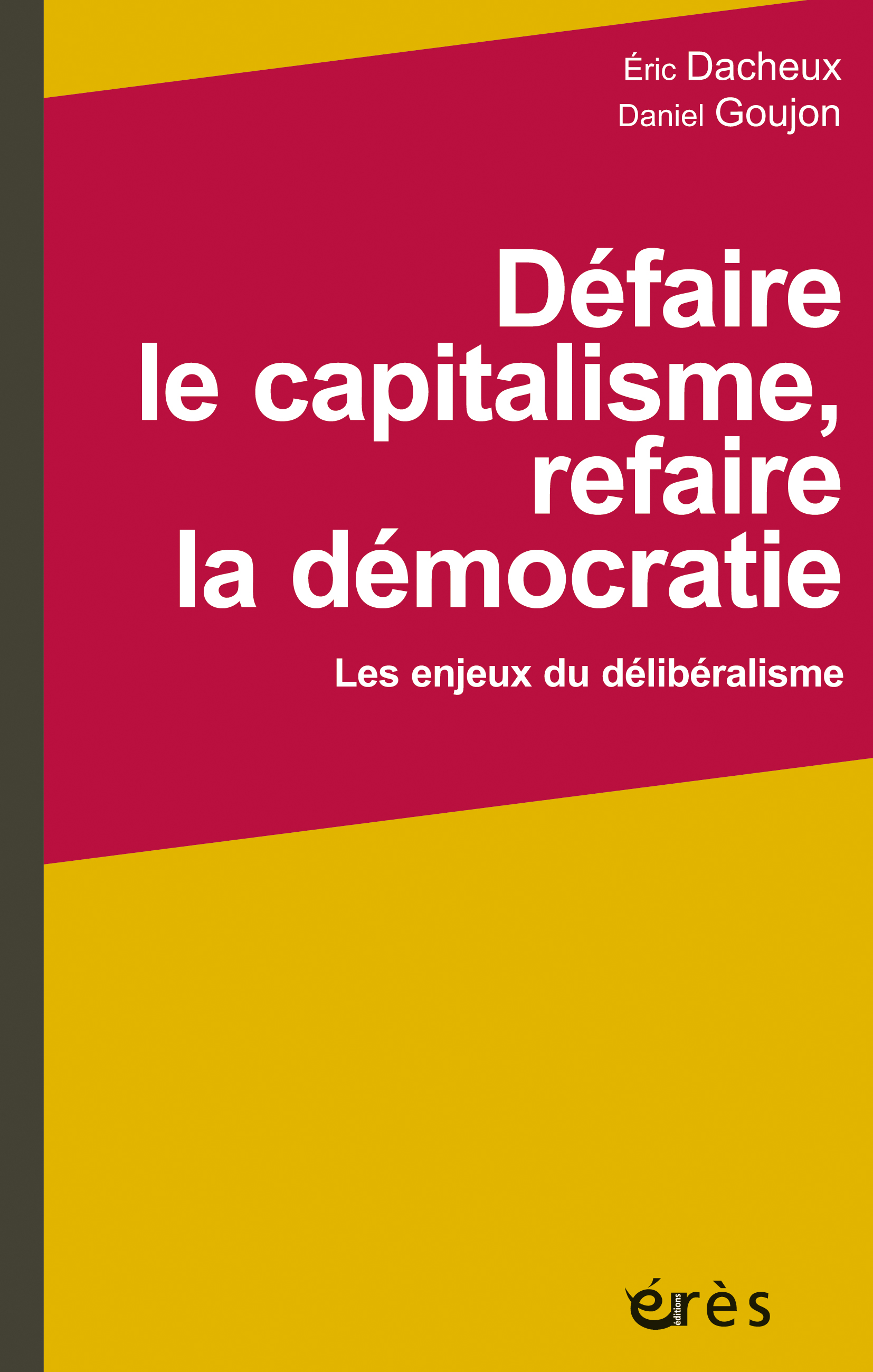 Pas de croissance infinie sur une planète finie.
Pas de croissance infinie sur une planète finie.
Selon une étude de l’université de Californie
(Johnson et al, 2020) 1, l’activité humaine
et la destruction de la diversité
seraient responsable
de l’apparition des nouveaux virus
comme le Coronavirus. Ainsi, la pandémie
du covid-19 joue un rôle de révélateur
de l’épuisement de notre modèle de croissance.
Il est temps d’inventer une nouvelle manière
de penser l’économie, c’est l’objet du délibéralisme.
En savoir plus sur le livre
Dans la vision dominante de l’économie, le problème est la rareté, sa solution la croissance. Il convient de rompre avec cette vision que K. Polanyi (2007) 2 nomme un « sophisme économiciste » où des désirs illimités se confrontent à des moyens de production forcément limités. Ce construit théorique inscrit les hommes dans une lutte permanente pour l’activité et fait du marché le meilleur moyen de gérer un état de rareté indépassable. Ainsi, toute l’activité humaine doit être mise au service du « produire plus », seul moyen de réduire la pauvreté engendrée par la rareté. Ce raisonnement qui, au passage, naturalise la pauvreté, se heurte aux limites environnementales. Il est impossible d’avoir une croissance infinie sur une planète finie. En effet, ce qui compte aujourd’hui, ce n’est plus l’accumulation irréfléchie des richesses mais la mise en valeur concertée des ressources existantes. « L'ordre économique est moins le résultat d'une nature des hommes et des choses considérées comme peu modifiables que l’œuvre d'activités et de choix délibérés » (F. Perroux, 1943)3. Dès lors, en sortant du productivisme, le travail – en particulier le travail salarié – cesse d’être une obligation indépassable, une malédiction naturelle, mais une activité humaine parmi d’autres, un choix individuel pensé dans un cadre collectif. Dans cette perspective, le travail n’est plus nécessairement la valeur centrale de la société, mais une valeur parmi d’autres. Ces valeurs ne sont pas qu’économiques (elles ne sont pas uniquement liées, comme le pensent la plupart des économistes, à la production ou à la consommation), elles sont fondamentalement sociales. Elles représentent, comme le disent D. Graeber (2001)4 et J. Dewey (2011)5, « ce à quoi nous tenons ». Elles résultent donc de choix politiques. Elles doivent être délibérées. C'est là le cœur du délibéralisme : le meilleur facteur d'allocation des ressources n'est pas le marché, mais le débat entre tous les citoyens concernés.
Lire l'extrait du livre "Défaire le capitalisme, refaire la démocratie" choisi par les auteurs
1Johnson C. (et al) 2020. “Global shifts in mammalian population trends reveal key predictors of virus spillover risk”, The royal society publishing, 08 Avril, https://doi.org/10.1098/rspb.2019.2736
2Polanyi K. (2007), « Le sophisme économiciste », Mauss, N°29
3Perroux, F. (1943). La valeur. Paris : Puf
4Graeber D. (2001), Toward an Anthropological Theory of Value, New York, Palgrave
5Dewey J. (2011), La formation des valeurs, Paris, La Découverte